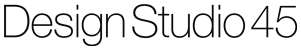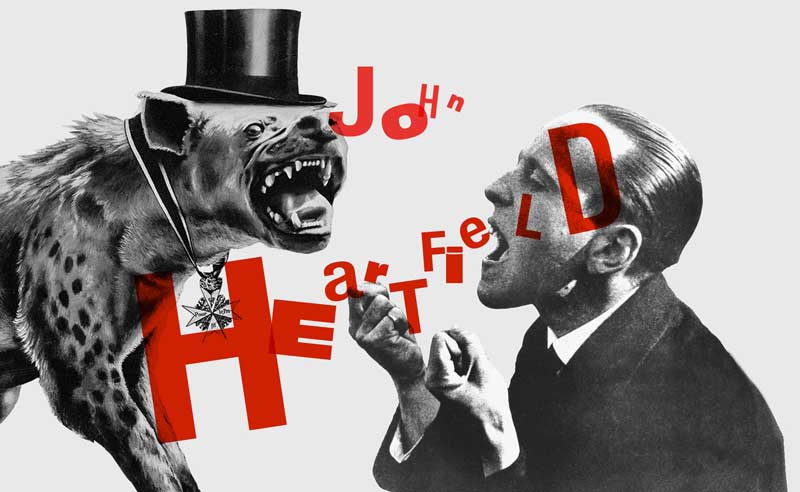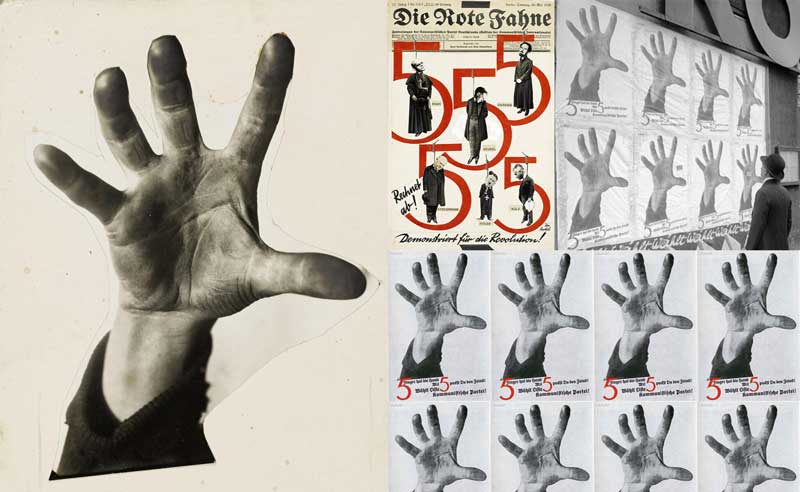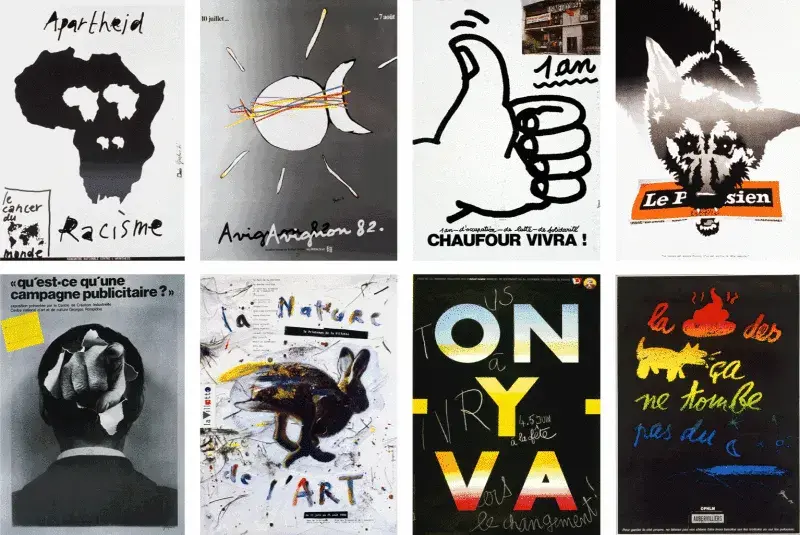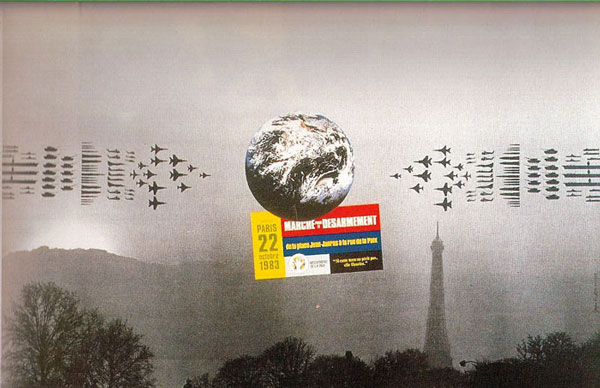Origine du mot MOT SPAM
SPAM facile à démouler et à trancher
Le mot SPAM vient d’une pub sur les radios anglaises en 70 pour une boite de jambon … pas bon et a inspiré les Monty Python dans une de leur série TV. Ce mot a fini dans le dico. Monty Python : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monty_Python

Le mot spam a un rapport avec le jambon. C’est la contraction de « SPiced hAM » (jambon épicé). Il s’agit d’un mauvais jambon en boîte américain, lancé en 1937 par la société Hormel Foods. Mauvais, mais populaire aux États-Unis dans les années 1970, grâce à de la publicité à la radio. Des messages radio qui passaient en boucle et qui martelaient le nom du produit pour que cela rentre bien dans les têtes des auditeurs : « Spam, spam, spam ! ».
Le phénomène était devenu tellement populaire, qu’il a inspiré un sketch aux Monty Python (pour les plus jeunes : Monty Python, c’était un groupe anglais d’humoristes, comme des youtubers, mais ça passait à la BBC…) Un sketch qui se passait dans un restaurant où tout le personnel répétait sans cesse : « Spam spam spam ! »
Spam : des déluges de messages sur internet
Spam est devenu synonyme de la publicité bourrage de crâne qui nous inonde. Le premier spam numérique de l’histoire remonte au 3 mai 1978. On le doit à un certain Gary Thuerk, qui a envoyé le même message à plus de 600 utilisateurs sur le réseau ARPAnet (l’ancêtre d’internet). Ces utilisateurs n’ont pas apprécié et comme les Monthy Python étaient très populaires à l’époque, notamment parmi les informaticiens et les pionniers de l’internet, ils ont rapidement associé l’envoi massif de mails au mot spam.
C’est ainsi que le spam est devenu le mot pour désigner les déluges de messages que l’on reçoit par internet. Souvent, c’est de la publicité. Parfois, ce sont des arnaques. On estime que 70 à 90% des messages qui circulent sur internet sont des spams. Avec une dépense énergétique non négligeable, mais on les voit de moins en moins car les logiciels de messageries, notamment Gmail(Nouvelle fenêtre), sont devenus très intelligents et arrivent à les bloquer avant même qu’ils n’arrivent sur nos ordinateurs. Cela dit, si le spam existe encore, c’est que ça marche.
Il y a toujours une proportion de gens qui cliquent sur les liens proposés. Soit pour acheter des articles, soit parce qu’ils se font avoir par des faux emails, ce qu’on appelle du phishing. Le mot a même franchi les frontières de l’e-mail, puisqu’on l’emploie aujourd’hui aussi sur les réseaux sociaux. En français : pourriel.
Source et texte :
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-d-ou-vient-le-mot-spam_4029119.html